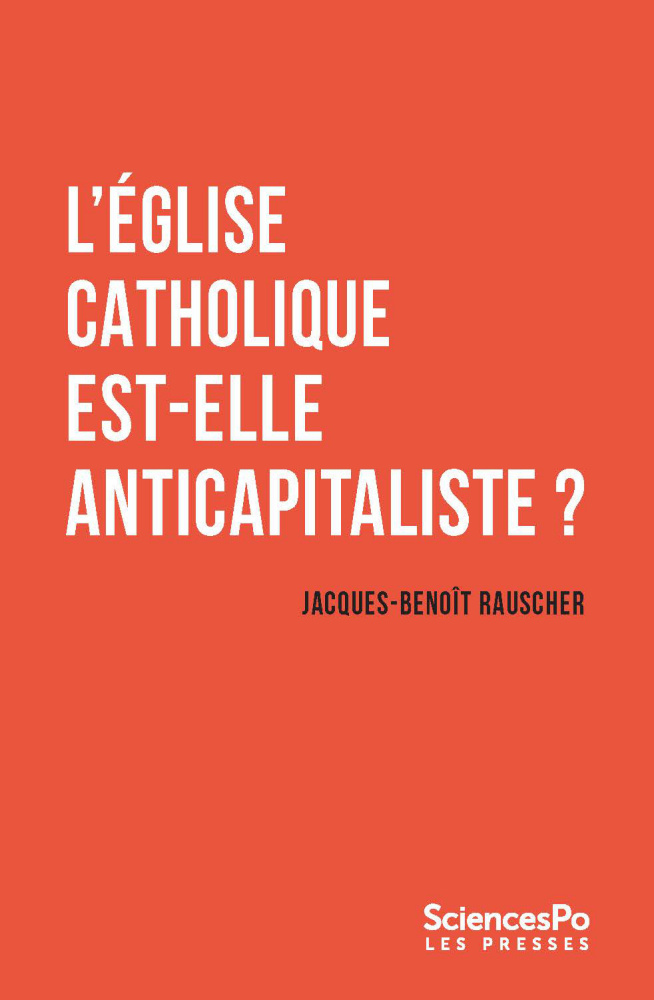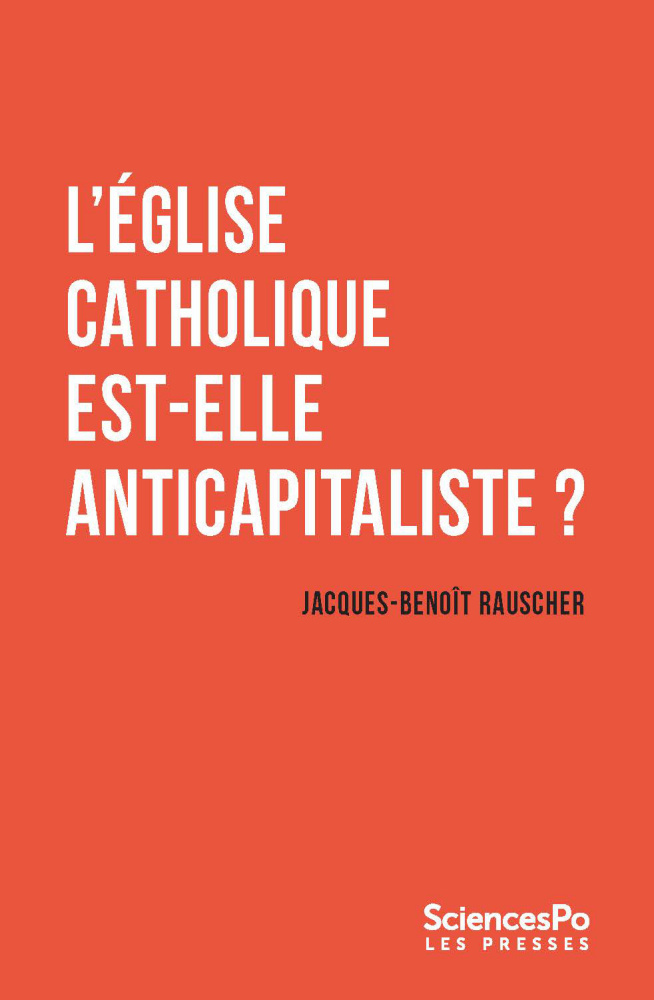
Chacun connaît les grandes lignes de la doctrine catholique concernant la sexualité ou la famille. En revanche, le regard de l’Eglise sur l’économie est largement méconnu au point que certains ont cru voir dans les discours du pape François une rupture anticapitaliste. Pourtant, il existe une doctrine sociale qui fut toujours méfiante envers le capitalisme. L’auteur, prêtre dominicain, s’attache dans cet ouvrage à expliquer le manque de lisibilité de ces positions.
Il tient notamment à la posture des pontifes. « L’absence d’une qualification économique nette du capitalisme vient donc d’un double vis-à-vis : le marxisme auquel [l’Eglise] ne veut en rien être associée et le monde en voie de sécularisation avec lequel elle cherche à maintenir, spécialement par sa doctrine sociale, un espace de dialogue qu’elle veut laver de tout soupçon de restauration. » (p. 28). Voulant se situer hors du terrain idéologique, ils se refusent à caractériser le capitalisme en tant que système économique. Léon XIII dans Rerum Novarum n’emploie pas même le mot « capitalisme ». Quarante ans plus tard, Pie XII ose user de l’expression, mais introduit dans le même temps une distinction entre un capitalisme qui serait recevable et un autre, excessif, qui serait condamnable. Quant aux questions économiques concrètes, la doctrine de l’Eglise brouille encore les cartes : en établissant que l’Etat doit garantir un fonctionnement concurrentiel du marché (Mater et magistra, MM 57 ; Centesimus annus, CA 48), elle semble soutenir une vision libérale de l’économie ; mais sur la question du salaire, la voilà plutôt keynésienne, en affirmant la particularité du marché de l’emploi (Quadragesimo anno, QA 81). Quant à la propriété privée, entre Léon XIII qui en cherchait le fondement dans le droit naturel et Jean-Paul II et François qui la subordonnent à la destination universelle des biens, la différence est palpable. Dans un autre registre, Benoît XVI déclarait que « le principe de gratuité et la logique du don […] doivent trouver leur place à l’intérieur de l’activité économique normale », ce qui fait plutôt penser aux mouvements anti-utilitaristes qu’à Milton Friedman. Cette approche dessine un pluralisme de capitalismes, qui peut donner l’impression d’un traitement « fantomatique » (J.-Y. Calvez).
Il existe pourtant un propos unifié sur le capitalisme au singulier dans la doctrine sociale. Mais il relève de l’anthropologie, considérant moins des objets économiques que des motifs éthiques et une mentalité. Ainsi, de la Bible à Laudato Si, l’Eglise condamne l’amour de l’argent, l’individualisme, le réductionnisme qui fait de l’homme un individu intéressé et amoral. Dès les premières encycliques sociales, la tyrannie de l’argent, l’avidité, mais aussi les fondements erronés de la science économique sont dénoncés avec fermeté. Cette définition de l’esprit du capitalisme culmine chez Jean-Paul II. Dans Centesimus annus (CA 42), il approuve un système économique « qui reconnaît le rôle fondamental et positif de l’entreprise, du marché, de la propriété privée et de la responsabilité qu’elle implique dans les moyens de production, de la libre créativité humaine dans le secteur économique ». Mais il désigne ce système sous le nom d’ « économie de marché », ou « économie libre » et réserve le nom de « capitalisme » à un « système où la liberté dans le domaine économique n’est pas encadrée par un contexte juridique ferme qui la met au service de la liberté humaine intégrale et la considère comme une dimension particulière de cette dernière ». Ce deuxième système, qui n’est pas seulement économique mais aussi politique et profondément éthique, s’attire une condamnation sans appel.
Après cette analyse du sens profond de la doctrine sociale, J.-B. Rauscher consacre un chapitre à présenter trois types d’attitudes catholiques à l’égard du capitalisme. La première serait l’intransigeantisme (Emmanuel Mounier, la théologie de la libération, les Focolari), qui rejette l’esprit du capitalisme et le système économique qui y est associé, cherchant une alternative macro- ou méso-économique. D’autre part, les réformismes (John A. Ryan, Louis-Joseph Lebret) cherchent à pallier les défaillances des structures capitalistes, sans se préoccuper de l’ethos qui leur est propre. Plutôt que de remettre en cause l’ethos capitaliste, ils cherchent comment agir vertueusement dans ses structures. Finalement, un « conciliarisme » (Michael Novak, Jean-Yves Naudet) tente de trouver des affinités entre le capitalisme et le catholicisme.
Dans un dernier chapitre, l’auteur constate qu’aucune de ces attitudes ne traduit vraiment la doctrine de l’Eglise – refus de l’ethos capitaliste et acceptation partielle de ses structures – et met en cause « l’attraction du catholicisme vers la modernité ». Cette dernière repose sur une alternative stérile. Le déontologisme se concentre sur l’ethos du capitalisme, quitte à détourner le chrétien de la nécessaire action dans le système présentement dominant ; le conséquentialisme au contraire ignore complètement l’éthique et n’est pas en mesure de juger le capitalisme autrement que d’après ses résultats, d’après des critères techniques et utilitaires. J.-B. Rauscher propose de chercher dans l’éthique des vertus un dépassement de ces apories, en revisitant à la suite d’Anscombe et McIntyre l’héritage (pré-moderne) aristotélo-thomiste.
En une centaine de pages, ce livre relève le défi d’introduire le lecteur à la doctrine de l’Eglise sur les questions économiques, en offrant des clés pour en saisir la cohérence et l’originalité. Les références données par l’auteur permettent de poursuivre la fructueuse réflexion ainsi initiée.
Louis de Bonnault